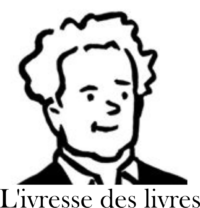Romain Janclaes publie ici sa première interview dans « L’ivresse des livres », un long entretien que lui accordé le philosophe Frank Pierobon à l’occasion de la parution aux Editions Vrin de son dernier essai consacré à « Oscar Wilde ou l’obsession de la beauté ». Le philosophe avait déjà publié à la même enseigne un « Kant et les mathématiques » et « Le symptôme Avatar ». Nous avions déjà eu l’occasion de l’interviewer à différentes reprises. Tous ces entretiens sont toujours disponibles à l’écoute sur notre site, comme celui consacré à « Salomé ou la tragédie du regard » . (Jean Jauniaux)
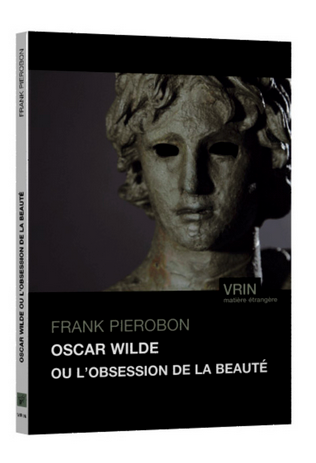
Romain Janclaes (RJ) Qu’est-ce quoi vous a poussé à écrire sur Wilde et sur son propre ouvrage, le Portrait de Dorian Gray ?
Frank Pierobon (FP) C’est une histoire amusante : en fait, il y a plus de vingt ans, j’avais beaucoup travaillé sur la Poétique d’Aristote. Ce traité examine au fond comment faire la plus belle des tragédies et ne propose pas l’analyse de l’essence de la tragédie en général ou de la quidditas proprement tragique. Comme on le sait bien, la Poétique a eu une influence énorme sur toute la littérature occidentale et j’en avais proposé une interprétation assez novatrice dans un livre paru aux Éditions du Cerf en 2009, L’humanité tragique, un gros pavé. Et je m’étais dit alors que si vraiment j’avais compris quelque chose à Aristote, je devais pouvoir appliquer ma grille d’analyse à une tragédie qui ne soit pas nécessairement grecque du temps d’Aristote parce que cela aurait été « ton sur ton » dans la mesure où Aristote prend lui-même beaucoup d’exemples chez Sophocle (Œdipe-Roi). Il me fallait identifier une prétendue tragédie bien plus récente et moderne pour la disséquer et pour éprouver la valeur de ma théorie de la catharsis aristotélicienne… Mon choix est tombé sur la Salomé d’Oscar Wilde dont j’avais gardé un souvenir assez lointain, sans parler de l’opéra de Richard Strauss … et surtout, c’était une pièce dans l’ancien goût orientalisant dont j’avais gardé un souvenir fasciné, l’ayant découverte très jeune. Et par conséquent, c’est fort indirectement que je suis venu à Oscar Wilde, c’est-à-dire à partir d’un souvenir d’un impact « tragique » obscurément bouleversant et ce gros travail sur Aristote qui lui-même avait été motivé par mon intérêt pour la philosophie classique et les Tragiques.
Je suis donc revenu à ces anciens souvenirs et j’ai relu Salomé. Et ce fut une redécouverte. En l’analysant vraiment en profondeur, je pouvais craindre d’être déçu. Mais ce ne fut pas du tout le cas, au contraire. Ce qui devait être tout d’abord qu’une illustration de mes propres thèses concernant la Poétique a pris forme et s’est imposé à moi-même : au prix d’un gros travail sur Wilde qui m’a de plus en plus passionné chemin faisant, je suis arrivé en gros à deux séries de conclusions. Les premières touchaient à Salomé : ce fut un livre qui a été publié en 2009 par les Éditions de la Différenceà Paris, avec le soutien du F.N.R.S. belge, sous le titre Salomé et la tragédie du regard (malheureusement, l’ouvrage est épuisé, tout simplement parce que l’éditeur a fait faillite dans l’année). Le second résultat d’un tel travail sur Wilde m’étonna au plus haut point : en lisant les œuvres de Wilde et surtout en prenant connaissance de la vie de Wilde par les nombreux ouvrages parus en Grande-Bretagne et aux États-Unis parus sur lui, j’ai réalisé qu’un schème tragique, détecté dans sa Salomé, expliquait tout aussi bien sa vie et en particulier son dénouement catastrophique – deux années de bagne pour gross indecency au terme d’un procès retentissant.
Il est difficile d’expliquer en quelques mots ce que j’entends avec cette notion de « schème tragique » : je pourrais dire, pour faire très simple, que chez les Tragiques, l’agent de l’action tragique se retrouve presque toujours détruit par ses conséquences. Tout comme Œdipe qui se targuait de déchiffrer n’importe quelle énigme, finit par devoir élucider la sienne propre, ce qui fait son malheur, c’est Oscar Wilde lui-même qui a lancé l’infernale machine judiciaire qui allait le broyer : il a intenté un procès en diffamation au père de son amant, le Marquis de Queensbury, qui l’avait accusé publiquement de sodomy… ça a fini très mal. Sans entrer davantage dans les détails, je voudrais simplement souligner le contexte de la vie d’Oscar Wilde, à savoir les lois particulièrement répressives que l’Angleterre victorienne avait mises en place suite au décret Labouchère en 1865 et qui valaient deux ans de bagne à toute personne convaincue de pratiques homosexuelles. La défense du marquis avait tout simplement consisté à prouver qu’en effet Oscar Wilde était vraiment un « sodomite » et qu’en le proclamant, on n’avait dit que la vérité. Les avocats ont d’ailleurs cité le Portrait de Dorian Gray pour étayer leur accusation. La charge s’était donc inversée, dans le plus pur style des intrigues tragiques…
RJ Et c’est Oscar Wilde qui s’est retrouvé accusé…
FP Tout à fait. C’est là l’essence du processus tragique : comme l’avait éloquemment souligné Odon Vallet, ce fut un cas d’« arroseur arrosé ». Oscar Wilde qui avait intenté ce procès pour diffamation à l’encontre du père de son amant, l’a perdu et il s’en est suivi un second procès qui a abouti à sa condamnation. Une fois mise en évidence, cette configuration me permettait de montrer comment une structure rhétorique littéraire – une fiction, c’est-à-dire une tragédie aristotélicienne – peut également fonctionner comme une structure existentielle – la dramaturgie d’un procès et la mort sociale qui s’ensuit.
L’écriture de ce premier livre m’avait permis de redécouvrir Oscar Wilde que tout d’abord je n’aimais pas tant que ça, et, parce que je l’avais détecté, d’approfondir les nombreuses allusions voilées de l’auteur de Salomé à philosophie grecque classique et hellénistique sur lesquelles j’avais par ailleurs beaucoup travaillé. J’ai pu ainsi réaliser que sur ce dernier point, Oscar Wilde était imbattable : il possédait en fait un bagage intellectuel de tout premier ordre, qu’il avait renforcé lors de son passage à Oxford. Il lisait les textes anciens dans le grec original, passait outre les prudentes interprétations qui avaient cours dans les universités de l’époque et, ayant remporté quelques prix académiques tout à fait prestigieux, il aurait pu aisément faire une brillante carrière universitaire.
La suite de la saga de mon livre sur Dorian Gray est tout aussi insolite dans mon propre parcours. De manière générale, si quelque chose m’intéresse, si une piste s’ouvre à moi, alors je la suis sans aucun souci d’un plan de carrière académique. Cela se révèle souvent très fécond, en tout cas d’un point de vue personnel. La scène décisive se passe dans le bureau de Jacques de Decker, le secrétaire perpétuel à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique (jusqu’en 2019) auquel je rendais souvent visite à son invitation pour boire le café au Palais des Académies. Un jour, en 2018, il m’accueille en me déclarant mystérieusement, sourire en coin : « Frank, je suis en train de lire un livre extraordinaire et fascinant… » et il me montre mon propre livre. Je le remercie et je lui explique que malheureusement, ce livre est épuisé. Il me répond aussitôt qu’il faut absolument le faire rééditer et je lui dis que c’est là beaucoup trop de boulot pour moi et qu’en plus, la moitié du premier chantier d’écriture a été relégué dans un fond de tiroir, à savoir l’analyse du Portrait de Dorian Gray.Je lui en dit deux ou trois choses qui l’enthousiasment. Et avec ses encouragements – il m’avait promis une préface –, je m’y suis remis en 2018. Mais il décède en 2020… Par fidélité pour son amitié et sa confiance en la valeur de ce que j’avais à dire sur Wilde, j’ai mené à bien ce projet sur quelques années, tout en travaillant à mille autres choses et cela a donné ce livre dont nous parlons aujourd’hui.
RJ Pensez-vous que Basil Hallward serait un peu l’autoportrait de Wilde et Dorian Gray, celui de ce qu’il aurait voulu être ou bien cet être qu’il aurait voulu connaître ?
FP Votre question contient déjà des éléments de sa réponse. Je fais en effet état d’une lettre que Wilde envoya à Ralph Payne le 12 février 1894 où il parle des personnages de son roman comme autant d’approches de sa propre personne. Le peintre est ce que Wilde lui-même croit être, Lord Wolton ce que les gens croient qu’il est, et Dorian Gray, ce qu’il aurait aimé être, mais « en d’autres temps, peut-être »… la caractérisation du peintre, Basil Hallward, permet à Wilde d’exposer tout ce qu’il pense sur la peinture, et il faut garder à l’esprit que c’est chez lui la métaphore de sa propre écriture. C’est un petit peu complexe mais tout est là : Wilde n’est pas ce personnage et pourtant il l’est quand même… C’est ainsi que, par espièglerie, il confère à son personnage de peintre une sorte de naïveté un peu bête, parfois même cocasse, face à Lord Henry Wolton, qui est par excellence cet homme du monde, fin et sagace, superbe d’intelligence souriante, bref celui que tout lecteur reconnaîtra comme un autoportrait en pied d’Oscar Wilde lui-même. Il est vrai que Lord Henry joue savamment avec les nerfs de son ami le peintre, l’amenant à dire malgré lui beaucoup de choses particulièrement importantes, comme s’il les pensait sur le moment. Le fait est que l’essentiel en provient d’un recueil d’essais critiques que Wilde avait publiés sous le titre Intentions en 1891, c’est-à-dire à la même époque que la rédaction du Portrait.
L’invention à l’endroit de Dorian Gray est bien plus radicale. Wilde en fait l’incarnation de la beauté absolue, ce dont le jeune homme, n’est absolument pas conscient : il ignore tout de la beauté en général, et surtout de la sienne en particulier. C’est l’œil du peintre qui la lui rend visible, en l’exaltant et la transcendant . C’est cet œil qui voit en même temps qu’il l’hallucine dans cette beauté physique une beauté métaphysique, selon un schème philosophique hérité de Platon. Cette révélation quasi visionnaire va amener Basil Hallward à réformer son art : il cessera, au sortir de ce qui est en fait une véritable conversion, à la Rilke, d’être un habile artisan au service de l’aristocratie. On le croyait bon peintre, il se découvre médiocre. Il veut désormais atteindre dans son art ce niveau de beauté qui est d’un autre monde. Cela est très grec, selon un idéal très connu des lecteurs cultivés de l’époque : c’est le kalos kagathos, à savoir la beauté et l’excellence conjointes en un seul homme.
Maintenant, quant à savoir si Oscar Wilde aurait aimé être lui-même absolument désirable, plutôt que de désirer absolument ce personnage dont il est quand même l’inventeur, sinon l’artificier, c’est une question qui appelle une réponse qui ne peut être qu’ambiguë et cela, pour des raisons très profondes : tout d’abord, Oscar Wilde évoque à travers Dorian Gray un autre jeune homme particulièrement énigmatique qu’il fait revivre dans un autre de ses livres moins connus, Le portrait de Mr. W.H. : il s’agit en effet d’un jeune homme un peu androgyne, que Shakespeare a idolâtré et dont ne sont connues que les initiales via la dédicace qu’il lui avait adressée en tête de ses Love Sonnets… Ensuite, et plus factuellement, Wilde façonne son personnage sur un « modèle vivant », comme on dit dans le langage de la peinture d’atelier : il s’agit d’un certain John Gray, qui a véritablement existé. C’était un prostitué de haut vol qui s’était forgé une façade socialement impeccable sans rien laisser deviner de ses propres origines misérables, qui s’était débarrassé de son accent des faubourgs, qui se vêtait avec un goût luxueusement discret tout en acquérant une culture tout à fait crédible et acceptable afin de pouvoir tenir compagnie à de riches aristocrates dans une société où il lui fallait jouer le jeu, se comporter de manière insoupçonnable et manifester une grande familiarité avec les us et coutumes de l’upper class…
L’origine documentaire du personnage de Dorian Gray relève donc d’un artifice, d’une construction, d’une imposture même, selon une configuration qu’Oscar Wilde affectionne dans ses écrits. Il a procédé à la manière du peintre qui transcende son modèle pour en faire quelque chose d’« artistique ». Cela a dû l’amuser. L’artifice est converti en fait de nature, avec ce dénominateur commun que Dorian Gray, tout comme son modèle originaire, est naturellement très beau. L’important, dans la perspective wildienne, est qu’il s’agit d’un fétiche : tout d’abord, c’est un tableau (et non une photographie réaliste), c’est-à-dire d’un simulacre particulier dont Dorian Gray serait à la fois l’original et le reflet… C’est voulu : à la lecture du roman, on ne doit plus savoir précisément qui des deux vient en premier, l’original ou son double…
Oscar Wilde a construit une œuvre d’écriture, et c’est un point sur lequel j’insiste : Le Portrait de Dorian Gray n’est pas un reportage. C’est une œuvre fantastique, une œuvre d’invention, dont on peut d’ailleurs rappeler ici les conditions de la genèse, qui elle aussi doit beaucoup au hasard. En effet, il s’agit à l’origine d’une commande passée à Wilde par un directeur d’un magazine de littérature assez populaire à Philadelphia… On lui passe commande d’un feuilleton, rien de plus. Quand bien même Londres est de loin toujours préférable à quelque patelin de l’autre côté de l’océan, cette offre inattendue, en fait, lui ouvre un espace de liberté extraordinaire. Wilde a pu ainsi écrire sans frein ni limite, dans un genre peu estimé, pour un magazine peu prisé, dans une ville que personne, dans Londres, ne connaît ou ne voudrait connaître.
Le Portrait de Dorian Gray est une méditation sur la beauté. Oscar Wilde, qui est ce qu’il est, qui n’est pas très beau, qui est un peu gourd, un peu massif mais qui a énormément de charme et d’esprit, ne peut pas vraiment se reposer sur son seul physique et cela va de soi, dans la mesure où, bien plus qu’aujourd’hui, l’éclat de la beauté et de la jeunesse est particulièrement éphémère. L’époque est dure. On se flétrit très vite et l’on vieillit très tôt. Toujours trop tôt viennent le déclin, la vieillesse, c’est-à-dire un petit peu ce que ce tableau va finir magiquement par montrer, avec outrance. C’est un topos shakespearien bien connu : le temps fait son œuvre et la beauté devient laideur. Celle-ci peut à loisir se faire le signe du démoniaque qui transparaît obscurément dans la chair, tout comme la beauté reflète la lumière d’une idéalité céleste. Mais tout ce qui est trop proche du divin est périlleux pour les humains, les anciens Grecs le savent bien, et Wilde aussi, qui les connaissait si bien.
Le Portrait de Dorian Gray est en fait un livre moral comme son auteur lui-même le croyait, et il faut, après l’hypothèse donnée au tout début d’une beauté absolue chez Dorian Gray, s’interroger sur ce qui joue le rôle de déclencheur de la tragédie, dans ce roman-feuilleton si vite écrit et somme toute un peu foutraque dans sa première version. De quoi ça parle ? De quelqu’un que tout le monde admire, qui est très jeune et donc un peu nunuche. Il est ensuite question de cette auto-conversion que produit sur lui la vue de sa propre image – un chef-d’œuvre hors norme dont on saura bientôt qu’il est inspiré par le désir que le peintre conçoit pour lui – vient aussitôt un aria di bravura, le prêche de Lord Henry qui l’encourage avec emphase, de vivre « la vie merveilleuse » qui est en lui et d’être « toujours avide de nouvelles sensations. » Tout cela dans les premiers chapitres. L’atmosphère est d’emblée fantastique. On pense à Méphistophélès qui offre à Faust le pouvoir de séduction instantanée propre à une beauté diabolique pour prix de son âme. mais Dorian Gray, au début de sa course à l’abîme ignorait qu’il possédait l’une et l’autre.
La beauté absolue est en soi une idée surtout fantastique ! Wilde, l’écrivain, sait très bien ce qu’il fait ; c’est en tout cas quelqu’un de particulièrement lucide. Son schème fantastique revient à faire accepter l’idée que le tableau et son modèle, à un moment magique, soient devenus interchangeables, comme si l’un était le corps et l’autre, l’âme, de la même façon que l’un est un être vivant, et l’autre, un miroir magique, un tableau, un fétiche.
Si j’insiste tant sur le fait que le Portrait de Dorian Gray est une œuvre d’écriture, c’est pour faire comprendre qu’un être humain tel que Dorian Gray ne peut pas exister dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Ça n’existe pas, dans la vie, une personne qui pourrait plaire universellement à tout le monde avec la même puissance, sa vie durant, qui plus est. Chacun a son idée de ce qu’est la beauté. Le medium de l’écriture est requis pour faire croire à chaque lecteur que sa propre porte ouvre sur l’universel. À cet égard, je signale dans mon livre le fait que les adaptations cinématographiques de Dorian Gray ont toujours été particulièrement décevantes, parce que l’inutile vérité réaliste du médium terrasse le spectateur par son accablante niaiserie et réduit à rien l’enchantement spécifique que produit sur notre imagination par le littérateur, justement par l’irréductible approximation de l’écriture, qui laisse toute sa place à l’effet poétique. En effet, chacun porte en lui/elle sa propre idée de la beauté qui se déploie à la lecture du roman : ce que l’on voit en songe existe dès lors qu’on le voit. L’important chez Wilde, c’est la vision, bien plus que la vue proprement dite. Voir la beauté, pour lui comme pour les anciens philosophes grecs, c’est à la fois voir une beauté qui existe réellement et que l’on peut voir de ses yeux en même temps que la vision devient un mode de participation essentielle avec l’idéalité platonicienne.
Wilde, en détaillant l’itinéraire émotionnel et artistique de Basil Hallward, souligne que l’art risque toujours déjà de se dégrader en artifice, surtout s’il revendique un certain réalisme photographique qui pourrait sembler plus facile et plus expédient. L’artiste véritable ne peut se limiter à « reproduire » ce qu’il perçoit comme beauté, ne serait-ce que parce qu’il en hallucine l’essentiel. Il ne peut y réussir qu’en s’évertuant au chef-d’œuvre, ce qui est bien sûr une gageure. Qui plus est, l’archaïque conception grecque du regard en fait une conjonction entre voir et être vu, bien loin de l’unilatéralité du processus photographique – un portrait produit par réactivité chimique à la lumière ne saurait nous « voir » ou nous « rendre » notre propre regard. D’où mon choix du bronze aux yeux vides pour la couverture de mon Oscar Wilde et l’obsession de la beauté.
RJ Vous écrivez (page 49) que ce roman présente une atmosphère angoissante avec ce Fog londonien qui représente le danger… Pourquoi, selon vous, Wilde a-t-il voulu cette atmosphère et serait-ce donc parce que c’est un peu dans l’esprit de l’époque, comme on voit dans les romans de Conan Doyle ou d’Agatha Christie ? Il y a un peu cette même ligne de fond <chez ces auteurs, mais> est-ce que vous pensez que c’est juste l’époque qui le veut ou bien est-ce vraiment une conviction personnelle de la part d’Oscar Wilde ?
FP Non, ce n’est pas une conviction personnelle de la part de Wilde car on ne peut pas avoir de telles convictions à propos de la météo, voyez-vous ! Je ne sais pas si vous garderez cela dans l’interview… (rires) Mais vous touchez au vrai, là… Alors Agatha Christie [1890-1976], c’est un petit peu postérieur à l’époque de Wilde, mais par contre Arthur Conan Doyle [1859-1930], mais aussi Robert Louis Stevenson [1850-1894], l’auteur du Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde(1886), H. G. Wells [1866-1946], l’auteur de The Time Machine (1895) et de l’Invisible Man (1897), relaient tous, au fond, une certaine vogue populaire du fantastique dont l’origine remonte, pour faire simple, à Mary Shelley, la sœur du poète, avec son célèbre Frankeinstein or The Modern Prometheus (1818)… Dans tous ces ouvrages, le brouillard londonien si caractéristique (le « fog », voire le « smog ») est l’élément énigmatique et angoissant qui est caractéristique de Londres à cette époque. Cela étant, dans ses Intentions, Wilde identifie, de par un mot d’esprit extraordinaire, le véritable inventeur du brouillard : c’est le grand peintre William Turner [1775-1851] dont il dit qu’il a inventé le brouillard en le peignant. Auparavant, on n’en remarquait rien et maintenant, avec Turner, on ne voit plus que ça.
Cette amusante digression me permet de souligner combien pour Wilde l’art est ce qui rend visible. Il est sensible à cette espèce de transcendance qu’opère l’art sur le visible et qui permet de voir le beau dans quelque chose qui pourrait n’être que joli, voire inintéressant. Le regard crée la beauté en même temps qu’il la reçoit, et c’est là une référence profondément grecque. Pourquoi affirmé-je cela ? Parce que les anciens Grecs avaient une conception du regard bien différente de la nôtre, laquelle est foncièrement photographique. En effet, dans la photographie, tout le visible est rejeté d’un côté et tout le voyant, de l’autre. Cela fait de la vision photographique une sorte de voyeurisme qui d’ailleurs lasse très rapidement. Or, pour les Grecs qui, en général, disposaient d’assez peu d’images artificielles, il va de soi que si vous pouvez voir le soleil – ou plutôt avec le soleil – c’est bien parce que ses propres rayons se mélangent avec ceux de votre regard, lequel émet un rai ténu de visibilisation comme Platon l’explicite dans son Timée : la vue procède d’une forme de participation où l’agent et le patient se conjuguent dans l’évènement même du voir. Cela explique d’ailleurs que les Platoniciens méprisaient l’image peinte, et bien sûr, Oscar Wilde n’ignore rien de tout cela, puisqu’il lit avec passion les textes dans l’original. Cette problématique étant un petit peu technique et complexe, je vous renvoie à mon ouvrage L’œil solaire paru chez MétisPresse, à Lausanne, en 2015, avec le soutien du gouvernement français : je souligne combien la l’académisme philosophique reste aveugle à la différence fondamentale entre la conception antique du regard et la nôtre, reconfigurée en profondeur par l’avènement de la photographie. L’interprétation de la pensée de Platon et de Socrate s’en trouve bouleversée.
Tout cela est essentiel pour la lecture du Portrait de Dorian Gray : la beauté, chez Wilde, est affaire de visible et d’invisible, de regard, de vue, de vision tout autant que de lumière et d’éblouissement. Le phénomène de la beauté, surtout si celle-ci est absolutisée par la médiation de l’écriture, résulte à la fois de l’agentivité du regard – surtout s’il s’agit d’un peintre – et de l’émanation tout aussi active de la beauté. Celle-ci, dans le meilleur des cas, est une splendeur dont le mode de fonctionnement équivaut celui de la lumière, et cela se vérifie dans la vie quotidienne : en effet, quand quelqu’un de magnifique entre dans la pièce, tous les regards se tourne irrésistiblement vers lui/elle, comme s’il y avait là un foyer ou un focus d’où émanerait une force à laquelle personne ne pourrait résister, indépendamment de toute considération sur le désir et son orientation sexuelle… Wilde s’empare de ces paradigmes et les porte à l’incandescence dans son roman, qui en tire son pouvoir proprement « fantastique ».
À cet égard, demandons-nous pourquoi, depuis le XIXème siècle qui voit l’essor de la Modernité, le public populaire adore le fantastique. On retrouvera ici tous ces auteurs qu’on a cités plus haut et qui sont au fond les précurseurs du film d’horreur. … Il est vrai qu’on aime bien avoir peur et frissonner délicieusement. Cela nous ramène à cette idée du fog sur laquelle vous m’interrogiez : je dirais que cette météo-là est à la fois physique – il y a du brouillard – et en même temps métaphysique – cet invisible-là est habité, hanté, menaçant. Dans ce livre de Wilde en tout cas, j’y détecte la métaphorisation fort discrète de l’atmosphère irrespirable d’une société victorienne, particulièrement coincée, hypocrite et violente, dont la violence est tout d’abord politique et économique, avec, bien sûr, sa dimension de répression implacable de tout désir et de toute sexualité. En particulier, à partir de 1865 et du Décret Labouchère qui interdit toute pratique homosexuelle sous peine de travaux forcés,, toute une partie de la population qui jusque-là était bon gré mal gré intégrée dans la société se voit spectaculairement stigmatisée : on envisagera désormais l’homosexuel comme relevant pathologiquement d’une nature non seulement anormale mais aussi inacceptablement pervertie : on est porté à y détecter l’œuvre du mal, qu’on l’envisage du point de vue politique (comme un crime), médical (comme une pathologie de la dégénérescence sociale) ou religieux (comme un péché absolu). Tout cela fut d’ailleurs est caractéristique du XIXèmesiècle. Auparavant on savait bien qu’existaient bien sûr des pratiques hétérosexuelles et homosexuelles et on pouvait même y objecter pour des questions de religion et de moralité. Le XIXème a inventé progressivement l’idée fatale d’une nature anti-nature, ce qui, en soi, est déjà un concept proprement « fantastique ». Shakespeare peut bien écrire dans ses Love Sonnets une petite centaine de déclarations d’amour pour un jeune homme – le fameux Mr. W.H. – les deux autres tiers s’adressant à des femmes. Rien de tout cela n’aura prêté à conséquence, d’autant plus que de par l’interdiction faite aux femmes de monter sur scène et d’y jouer la comédie, leur emploi devait être pris en charge par des hommes assez juvéniles et androgynes pour « faire la femme », de manière convaincante sinon désirable, en pleine connaissance de cause. La chose est bien connue et l’homosexualité ou la bisexualité de William Shakespeare n’aura jamais compromis sa gloire de premier poète de l’Angleterre. Encore aujourd’hui, ces Love Sonnets font partie du patrimoine de la culture britannique : encore aujourd’hui, on les loue, on les récite ou on les chante à toute occasion. Oscar Wilde était fou de Shakespeare. Il en parlait beaucoup dans ses écrits.
RJ Pouvez-vous revenir aussi sur ce que vous écrivez page 64 « la thèse fondamentale selon laquelle la beauté suscite l’œuvre et l’œuvre exalte la beauté qu’elle découvre pour la transfigurer et/ou qu’elle transcende et réinvente ». »
FP C’est une phrase un peu technique…
RJ … mais je trouve que c’est un peu l’essentiel…
FP Oui. Vous avez parfaitement : c’est l’essentiel. Dans l’hédonisme actuel, on pare au plus pressé : la beauté est devenue consommable et elle a cessé d’être la beauté. Désormais une pléthorique pornographie est accessible à tous et sans effort, et parallèlement, il existe aussi des drogues de synthèse, tout aussi disponibles, qui vous procurent des décharges neuronales effrayantes de violence et qui vous font croire à l’extase pour tous. Oscar Wilde appartient encore à une époque où le plaisir supposait inévitablement un véritable travail, que l’on peut comparer à celui de la poésie ou de la musique… À cette époque où il y avait un piano dans chaque maison et l’on trouvait normal et fondamental d’apprendre par cœur des milliers de vers, la distance entre la compositeur et l’interprète, ou de l’interprète et le simple auditeur, était bien moins grande qu’aujourd’hui.
« L’essentiel » comme vous dites tient à ce qu’on ne saurait accéder à la beauté, dans tous les sens de ce terme, aussi facilement que s’il suffisait de glisser un euro dans la machine après avoir encodé son choix… Pour Wilde, il y va d’une espèce de mysticisme, d’ascèse et de travail, ce dont le parcours artistique du peintre Basil Hallward détaille les différentes dimensions. En effet, il aura fallu cette passion soudaine et toxique pour Dorian Gray pour qu’il se réinvente en profondeur : tout d’un coup, il s’éveille à l’essentiel, pour le mieux comme pour le pire, et c’est cela qui est intéressant. S’agissant de Wilde, dans sa position d’auteur, il faut remarquer qu’une telle conversion à l’essentiel sera postérieure à l’écriture du Portrait, mais qu’elle inspirera Salomé, avec toute sa flamboyance et sa charge profondément tragique.
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas minimiser ce paradoxe : la beauté de Dorian Gray est et n’est pas ce que le peintre en voit. Elle est à la fois objective et objective dans la mesure où elle réside aussi dans son propre regard d’artiste. Or c’est le lieu, peut-être, de rappeler que le Portrait de Dorian Gray est avant tout un roman, c’est-à-dire une écriture et en cela une œuvre d’art comparable à celle du peintre, et non pas, par exemple, un reportage ou un film avec son horizon indépassable de ressemblance objective. Peut-être que dans la « vraie vie », ce peintre aurait été tout au plus touché, voire séduit, par ce modèle exceptionnellement magnétique et qu’il en serait peut-être même tombé amoureux. Peut-être même que sa passion amoureuse l’aura transformé en profondeur, tout comme Shakespeare le fut par le mystérieux dédicataire masculin de ses Love Sonnets. Il y a de cela dans le Portrait : le désir sexuel intensifie l’acuité du regard, qu’il soit celui de l’amoureux ou du peintre qui voudra voir toujours mieux et toujours plus en peignant l’invisible dans le visible. C’est un regard qui va chercher l’idéel dans le réel, sans que l’on puisse déterminer s’il le trouve effectivement et objectivement ou s’il l’invente ou l’hallucine. Chez Wilde, contrairement à ce que laisse penser sa légende dorée, la rencontre avec la beauté ne se laisse pas réduire à sa dimension sexuelle, mais celle-ci ne peut pas non plus être totalement refoulée. Raison pour laquelle, l’on aurait tort par conséquent de faire semblant que tout est « convenable » dans ce livre, même ses allusions cryptiques. Il est constamment question de sexe dans le Portrait de Dorian Gray avec une puissance fantastique paradoxalement intensifiée par le fait qu’il n’en est jamais nommément question.
En tout cela, la source d’inspiration de Wilde est très clairement platonicienne, et c’est essentiellement celle du Banquet : dans ce dialogue, l’un des protagonistes propose l’éloge d’un Éros dédoublé : il convient, d’une part, de compte de l’Éros terrestre, qui s’en tient au seul désir sexuel et d’autre part, de l’Éros céleste qui ne méconnaîtrait pas la chair mais qui y trouverait cependant de quoi élever. Le contraire de l’Éros exclusivement sexualisé n’est pas du tout, chez Platon en tout cas, à chercher dans une sublimation totalement conditionnée par sa complète désexualisation. L’idéal platonicien, que les lettrés britanniques, à la suite de Walter Pater, plébisciteront sous l’appellation d’« idéal hellénique » est le kalos kagathos, qui conjoint la perfection visible, plastique et physique du corps et à la stature morale et métaphysique de l’esprit, moyennant dans les deux cas une éducation tout à fait soignée. S’il y a bien quelque chose que Wilde n’est pas, c’est l’adepte d’un plaisir qui ne serait que platement hédoniste et pour tout dire exclusivement « terrestre ». Dans sa propre obsession pour la beauté, entre toujours une part de mystique, qui l’inspire dans son œuvre d’écrivain avec un engagement tel que l’on peut bien penser que le travail de l’écriture est ce qui révèle ce que la beauté peut receler d’idéalité surhumaine.
RJ Quand vous écrivez <l’expression :> « l’œuvre », ce n’est pas l’œuvre comme dans le chef-d’œuvre mais plutôt l’œuvre, le travail ?
FP Tout à fait. C’est une certaine dynamique laborante qui conjoint tant la création artistique que sa réception adéquate au sein d’un public qui se doit par conséquent d’être suffisamment cultivé. Cela peut aller très loin et il faut se remettre dans le cadre de pensée propre au XIXème siècle : c’est ainsi que vous ne pouvez pas vraiment comprendre et apprécier une poésie si vous ne l’apprenez pas par cœur, avec du travail, de la discipline et de la méthode… Il vous faut, à partir et au-delà de cet apprentissage, la réciter jusqu’au moment où tout d’un coup vous réalisez que c’est bien la voix du poète qui s’empare de vous et de votre âme pour emprunter votre corps et se faire ainsi entendre. Et à nouveau tout cela est tout à fait grec. Il n’y a pas d’esthétisme au sens ordinaire du terme dans l’Antiquité : d’emblée, il s’agit de se laisser divinement possédé – tout cela est bien décrit et discuté dans l’Ion de l’inévitable Platon. C’est la même chose pour le pianiste : vous allez tout d’abord mettre en place toute la petite cuisine, fixer des doigtés appropriés, rejouer tant et plus tel passage difficile, veiller à user des pédales à bon escient… C’est toute une machinerie d’artifices. Et puis, arrive un moment où tout d’un coup, vous avez attrapé le ton juste. L’avez-vous appris, ce ton juste ? – Non, ce ne serait pas possible ! Certes, il existe bien des gens qui ont travaillé cent fois telle ou telle œuvre mais qui la joueront toujours aussi mal. On n’entend que leurs doigts car ils ont appris malgré eux à mal jouer. Alors là, je ne puis m’étendre davantage sur ce sujet parce que cela nous ferait sortir du sujet du livre mais la question demeure : comment fait-on pour être pris ou possédé par cette inspiration qui semble naître en vous en même temps qu’elle paraît venir d’ailleurs ? Tout d’un coup, dans le meilleur des cas, vous êtes possédé par je ne-sais-quoi au lieu d’être dans le faire de l’œuvre : car, en fait, tout d’un coup c’est l’œuvre qui vous refait – je joue un peu sur les mots ! Je crois qu’Oscar Wilde était tout particulièrement conscient de tout cela, dans sa complexité dialectique, et c’est ce que j’ai tenté de montrer.
RJ Est-ce que votre travail s’appuie sur la simple analyse du Portrait de Dorian Gray ou bien est-ce que vous avez consulté d’autres sources, d’autres écrits ?
FP C’est en fait une question de méthodologie et je vais laisser un petit peu son aspect documentaliste pour la seconde partie de ma réponse. En premier lieu, j’ai pris un soin tout particulier, au début de ce livre-ci, à préciser ce que je conçois la finalité d’un commentaire. Ce faisant, je reprends à mon compte le mot de Friedrich von Schlegel : « un jugement sur l’art qui n’est pas lui-même une œuvre d’art (…) n’a pas droit de cité au royaume de l’art » (Athenaeum, 1798). Autrement dit, à une œuvre d’art qui solliciterait votre attention, il conviendrait de répondre par une autre œuvre d’art, qui se hisserait sui generis au même niveau. Cela signifie pour moi qu’il me faut envisager mon travail philosophique, aussi discursif qu’il puisse paraître, comme une œuvre, et par conséquent comme une œuvre d’art. Il s’ensuit que l’on peut alors interroger la pertinence du genre proprement philosophique, avec son appareil critique, ses citations, etc., par rapport à une œuvre d’art, dont les lois sont tout autres. Le fait est que je ne quitte jamais le domaine de l’écriture et que je ne m’aventurerais pas à analyser ou déconstruire quelque musique, alors que c’est un genre qui me passionne au plus haut point, ou encore quelque peinture. D’où mon intérêt pour le traitement à la fois fantastique, fictionnel et réflexif par lequel Wilde fait vivre son personnage de peintre, avec ses certitudes et ses incertitudes. Dans un tel contexte, mon art exégétique, consiste en quelque sorte à mettre au jour au sein de l’œuvre à laquelle je m’intéresse – qu’elle soit proprement philosophique ou plus généralement littéraire – des significations que j’ose appeler « spirituelles » et qui sont peut-être restées enfouies ou enchevêtrées dans ce qui fait la matière écrite de l’œuvre. Le fait est que j’interroge en même temps l’énigme inhérente à mon premier choix, comme si je me demandais toujours ce qui me retient dans telle ou telle œuvre écrite.
Et cela suppose beaucoup de travail de recherche documentaliste, pour vous donner enfin la seconde partie de ma réponse, qui est celle des sources. Il faut se méfier de soi-même et surtout, de ses « intuitions » et s’en méfier à concurrence de ce que l’on n’a rien d’autre, en fin de compte, pour se guider. Dans ce genre de travail, philosophique ou critique, il faut travailler à rassembler des faits, ce qui implique que l’on accepte peu ou prou de se laisser happer par la masse proliférante d’écrits dignes d’intérêts où l’on risque de se perdre. Ne rien écarter a priori et ne rien non plus accepter parce que « c’est comme ça qu’il faut faire »… D’où cette idée de l’œuvre d’art appliquée à la philosophie, à savoir qu’il faut assumer cette position incommode d’équilibriste, où il faut respecter l’archive, l’écrit, le document, le fait, et qu’il faut en même temps travailler à l’éclairer par une lumière dont l’archive documentaire ne peut pas être l’unique source. Toute œuvre intéressante possède en elle-même quelque chose de transgressif ou de révolutionnaire par rapport aux conventions et aux idées reçues de son époque. C’est le cas pour les grands philosophes tel que Kant, sur lequel j’ai beaucoup travaillé, et, c’est également le cas pour les grands écrivains, tel que Wilde, qui peut paraître un nom inattendu dans un tel contexte. Le fait est, je l’ai dit, que Wilde possède une immense culture dont il ne fait jamais montre et qu’il joue l’Ancien contre le Moderne, dans sa protestation contre la violence, fasciste avant l’heure, de la société impériale et impérialiste de l’Angleterre. N’oublions pas qu’il était et qu’il est resté toute sa vie un Irlandais, et par conséquent un être viscéralement méfiant vis-à-vis de la brutalité et de l’hypocrisie des élites britanniques. Quant à son écrire et son engagement littéraire, il veut résister à la vogue réaliste et documentaire et se définit volontiers comme un visionnaire dans l’écriture, raison pour laquelle il dit préférer Balzac (qui a « tout inventé ») à Zola dont la vocation « réaliste » est en réalité et malgré lui fort journalistique. Chez Wilde, la réalité de l’art, c’est-à-dire sa raison d’être, lui vient de son irréalité.
Dans le cas particulier de ce livre, la dimension analytique de mon interprétation du Portrait de Dorian Gray (ou en tout cas de ses parties les plus essentielles à mon sens) est indispensable, et je l’ai voulue aussi rigoureusement documentée qu’il m’était possible, c’est-à-dire en me gardant d’écrire six cents pages… Si je puis faire valoir la très grande liberté de ton et de propos de ce roman fantastique, je ne voulais pas en taire le caractère fortuit : Wilde a en effet saisi cette opportunité inattendue pour donner libre frein à sa fantaisie, à son daïmôn, et cela lui est venu sans qu’il en ait le projet dûment délibéré. Cette grande liberté fut dans sa vie un accident exceptionnel et providentiel, car en fait, pour lui, ça n’existe pas, quelque chose comme Philadelphie, au regard de Londres et de cette bonne société au sein de laquelle il voulait, malgré tout, être admis, admiré et même fêté. Il se retrouve, comme en récréation, à faire quelque chose qui l’amuse, qui l’excite, qui le séduit, comme vous voudrez… Quelque chose se met en branle dans le meilleur des cas, car il ne suffit pas d’écrire pour écrire bien, ou d’écrire bien pour que l’inspiration s’empare de vous et vous dicte ce qui s’imposerait venant du ciel sans défense possible de votre part. Comme beaucoup d’écrivains de son époque, il veut être lui-même sans trop savoir de quoi il retourne et en même temps il veut être accepté, fêté, applaudi par un monde littéraire dont il ne pense pas que du bien. Cette ambiguïté est de facto incontrôlable : Wilde aurait pu rester un dandy prisonnier de sa propre posture, un juif de cour dans une société particulièrement répressive. S’il s’est libéré par l’écriture, c’est tout d’abord parce que se sont présentées à lui un ensemble de circonstances qui ont libéré sa propre écriture, en la soustrayant du monde littéraire londonien qui fonctionnait alors comme une société de cour (Nobert Elias) en laquelle tout le monde surveille tout le monde avec pour effet une sorte de stérilisation généralisée.
Mon livre est encore et toujours un livre sur l’écriture, car c’est cela, l’écriture : quelque chose s’empare de vous et de vos personnages ou de votre propos ; dans le meilleur des cas, elle vous mène irrésistiblement jusqu’à un dénouement inattendu, qui peut vous surprendre et vous enchanter… Wilde dans son recueil Intentions ne cesse de commenter ce pouvoir de l’écriture poétique, qu’il oppose en cela au journalisme réaliste. Nombreux sont les écrivains de premier plan qui font état de cet état d’égarement inspiré, qui les font écrire comme jamais ils s’en seraient crus capables (et je cite Marguerite Duras qui à cet égard me semble voire constamment juste). Pourquoi écrit-on ? – pour savoir pourquoi on écrit. Est-ce qu’on peut savoir pourquoi on écrit ? – Non, on ne le peut pas et c’est pour cela qu’on continue à écrire.
Je reprends le fil de la seconde partie de ma réponse à votre question. Comment fait-on ? Tout d’abord, on s’évertue à lire très attentivement ce texte-là qu’on a choisi de commenter… et j’ai lu toutes les versions originales du Portrait de Dorian Gray, depuis la première version brute et non expurgée du feuilleton, jusqu’à la version lissée, assagie et augmentée en livre, du roman, lequel fait à peu près le double de la version originale… J’ai lu ensuite et très attentivement les différentes traductions, les commentaires des uns et des autres, les études des spécialistes. De proche en proche j’ai fini par lire beaucoup sur les six ans que m’a pris ce périple intellectuel, sans parler de tout ce que j’avais accumulé comme notations pour mon livre sur Salomé paru en 2008. Ce n’est pas peine perdue, loin de là : l’on dit volontiers que le diable se niche dans les détails et il faut ajouter que c’est justement là que ça devient intéressant ! Pour finir, mon type de commentaire est extrêmement fouillé mais il porte, finalement, sur des parties finalement assez limitées du Portrait, que j’ai privilégiées pour leur teneur philosophique. Écrire, c’est réécrire. C’est là que le livre prend sa forme et trouve sa nécessité d’être, du moins à mes yeux. Un livre de ce genre me prend entre quatre et cinq ans non pas à l’écrire, mais à le finaliser, c’est-à-dire à l’élaguer, à supprimer les redites, les digressions, le bois mort… Et pour tout dire, dans un tel contexte, la documentation me sert tout d’abord à vérifier que des intuitions que j’ai pu avoir sont factuellement justes ou ne résultent pas d’illusions méthodologiques ou de lubies de ma part.
RJ Pensez-vous que la figure de Wilde et son culte de la beauté résonnent encore dans notre société contemporaine notamment à cause d’un nivellement par le bas ?
FP Voilà donc deux questions… Celle du « nivellement par le bas » sera la seconde des deux. Je commence par notre époque, où, plus que jamais, le recul de la spiritualité est quand même très marqué. Lorsqu’on se dit volontiers « dingue » de beauté, c’est encore et toujours dans une perspective consumériste, avec une certaine inquiétude existentielle, comme si l’on pressentait que l’on n’achète de la beauté qu’en raison de ses impalpables effets d’idéalité et qu’en définitive, l’on se retrouve avec une réalité qui se fane très vite, et qui, promettant d’être belle, n’est qu’assez faiblement « jolie ». Dans une telle situation, qui semble être la règle commune, la beauté dont on existe qu’elle soit immédiatement consommable, nomme à la fois un phénomène de surconsommation et une frustration assez généralisée. La religion de la beauté à l’usage des foules n’est pas autre chose que la publicité, avec sa culture propre, ses codes et son illusionnisme.
J’en arrive maintenant à la seconde partie de votre question, qui portait sur le nivellement par le bas. Je crois pouvoir affirmer qu’il s’agit là de l’épiphénomène d’une espèce d’addiction pour le joli, l’agréable et peut-être même le beau, une addiction que l’on retrouve jusque dans le titre de mon livre, Oscar Wilde et l’obsession de la beauté. Et cette addiction se nourrit de la frustration que je viens d’évoquer en même temps qu’elle la relance. Il y a une faim d’absolu dans toute obsession, dans toute addiction et chez Wilde, l’on peut encore apercevoir que la dimension sexuelle de cette obsession pour la beauté plastique, qui concerne le corps vivant davantage que sa représentation artistique, aussi géniale qu’elle puisse être, avoisine sans rompre sa dimension transcendante et mystique. Le langage de l’adoration mystique est en effet assez voisin de celui de la fascination intensément sexualisée.
RJ Partagez-vous la vision de Wilde ou bien par ce livre avez-vous voulu apporter votre propre vision dans ce qu’il écrit dans son Portrait de Dorian Gray.
FP Non, je ne la partage pas. Parce que tout d’abord, ce n’est pas une vision d’une seule pièce, unifiée… Ce serait plutôt un kaléidoscope. En fait, je trouve que c’est un livre… Comment dire cela ? Si Oscar Wilde avait été un bijoutier, et le Portrait, le bijou qu’il a forgé, je dirais que la monture en est fort baroque et fragile mais je m’exclamerais : « qu’est-ce que les gemmes sont belles ! » Par exemple, le traitement complet de son personnage du peintre est si dense et si riche qu’il mériterait d’être l’unique sujet d’un roman à lui tout seul. Un rapprochement pourrait être tenté avec Mort à Venise de Thomas Mann. Pour tout dire, je trouve que par moment, Wilde tourne un peu court. C’est un écrivain pressé, talonné par l’urgence, prescient peut-être de ce que le monstre qu’il ne cessait de provoquer ne tarderait pas à le broyer. Il avait raison. Reste alors une œuvre, qui, à part quelques exceptions grandioses (comme son Salomé ou son De Profundis) diffusent une lumière exceptionnelle.
RJ Alors que vous dites que dans d’autres moments il y a des longueurs
FP Oui bien sûr ! C’est à dire que Wilde a écrit un feuilleton et en fait, il s’est laissé posséder par son sujet et à travers son propos, par son propre désir, son tropisme pour des garçons plutôt androgynes et non pas pour des lutteurs de foire… Sur ce point, il ne faut pas s’y tromper : l’homosexualité de Wilde n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’on voit aujourd’hui dans la palette LGBTQ alors qu’on en a fait l’emblème culturel pour ainsi dire générique. Oscar Wilde appartenait bel et bien à son époque et sur ce point-là, il ne la transcendait pas. Mais cela étant, ce qui retient mon attention dans le Portrait de Dorian Gray, c’est tout ce qui concerne l’écriture, le travail de l’écriture. Wilde serait certainement surpris que je m’intéresse à la soupière et non pas à la soupe, vous voyez ? Le personnage du roman, que personnellement je préfère et auquel je consacre tout mon chapitre IV, ce serait plutôt Sibyl Vane, cette actrice insolite dont Dorian Gray tombe amoureux. Je ne manque pas de dire et de répéter que la pensée qui sous-tend tout ce passage dans le livre est magnifique, extraordinaire, exceptionnelle, etc., et j’en donne le détail. Mais, cela étant, la construction et l’intrigue plus particulièrement en sont tout à fait invraisemblables, bâclées sinon ratées, avec du remplissage de feuilletoniste que l’on aurait tort de taire et que des grands biographes comme Richard Ellman ont noté non sans sévérité. Avec Sibyl Vane, par exemple, c’est un festival d’invraisemblances : on a affaire à une actrice improbable qui se produit tous les soirs dans un rôle différent exclusivement tiré du répertoire shakespearien, sur une scène de dernier ordre, avec un public dont on devine la condition modeste et la basse extraction, dans le fin fond de l’East End, un quartier plutôt louche. Elle est très jeune, trop même, et pourtant, c’est une actrice de nature, accomplie, qui joue tout parfaitement, bien qu’à l’instinct… À l’occasion de son étrange sortie de scène qu’elle tire du côté d’une abstraction très moderne de distanciation, elle démontrera une intellectualité extraordinairement aiguisée avant de se suicider quand son ordalie – ou bien se sauver en brûlant le théâtre ou bien brûler elle-même pour cesser d’être un reflet ou un simulacre existentiel. Certes, l’intrigue avait besoin d’une historiette romantique, avec sa fin précipitée, en queue de poisson : Dorian devait tomber amoureux d’elle, mais sur la foi d’une illusion spécifiquement théâtrale. Il est indistinctement amoureux du génie de Shakespeare et de celui de son actrice, car, sur scène, il est en effet impossible de distinguer entre les deux…
La violente brutalité de son suicide masque l’opacité de ses propres motivations. Le lecteur ainsi choqué perd aussitôt de vue qu’il n’y comprend pas grand-chose, il faut le dire. De toute façon il est happé par la suite, parce que c’est à partir de ce point de crise que Dorian Gray amorce sa marche à l’abîme et que le tableau maléfique commence à muter. Or dans cette scène en laquelle elle performe avec une maîtrise extraordinaire son renoncement à toute théâtralité, une scène que j’analyse dans le plus grand détail, Wilde tente quelque chose de génial, philosophiquement parlant et pour le détail de tout cela, je dois renvoyer à mon livre…
Que puis-je en dire sans faire long ? Ce que Wilde a de génial est sa compréhension visionnaire du théâtre et du jeu de l’actrice ou de l’acteur. C’est ce qui retient mon attention dans cette partie qui met en scène Sybil Vane, un moment dans le Portrait de Dorian Gray dont l’auteur et son publicpouvaient aisément faire l’économie en se contentant d’une intrigue conventionnelle et attendue. Elle est belle, il est beau ; c’est une actrice surdouée, il adore le théâtre et apprécie au plus haut point son art ; elle veut être aimée non par pour son talent d’actrice mais pour elle-même, et lui n’y comprend rien, parce qu’il est foncièrement aimable et qu’il n’a aucun effort à faire pour cela. Le malentendu est total, et tandis qu’elle met en scène le vide propre au théâtre, elle disparaît à ses yeux, ce qu’il ne peut accepter, parce qu’elle n’est qu’une héroïne du théâtre shakespearien, ce qui n’est pas rien, bien sûr. Le voilà qui rompt. Elle se suicide. On passe à autre chose. Au niveau de l’anecdote, ça ne tient pas vraiment la route , mais dans un roman fantastique, l’invraisemblable ne constitue aucunement un problème ; le roman se lit vite, d’autant plus que la trouvaille majeure qui éclipse tout le reste est à chercher plutôt du côté de la mutation maléfique du tableau qui vieillit à la place de son modèle, lequel reçoit en échange de son âme la jeunesse éternelle. Tout tourne autour de cela, en effet, de ce pacte faustien qui se noue invisiblement, sans que le Diable n’apparaisse jamais. Certes, c’est une âme de plus en plus laide qui transparaît dans le vieillissement prodigieux du portrait et c’est là aussi une énigme particulièrement féconde… Mais quoi qu’il en soit, si, au niveau de l’intrigue, l’épisode de Sibyl Vane est un tout petit peu inabouti, on ne va pas pour autant en faire reproche à Oscar Wilde, d’avoir produit un « portrait » littéraire aussi extraordinaire, dont deux ou trois coups de pinceau auront peut-être été un peu donnés à la hâte et de traviole…
RJ Je vous la pose mais si vous ne voulez pas que je la mette dans l’article, je comprendrais : à qui s’adresse ce livre ? pour qui l’avez-vous écrit ? parce que j’ai vraiment aimé mais vous vous rendez compte quand même que si on n’a pas lu Wilde et même si on l’a lu il y a dix ans, on ne peut pas comprendre ce livre, je pense…
FP Alors moi, je vous réponds très volontiers ceci : personne d’honnête ne peut prétendre savoir à qui s’adresse son écriture. D’abord, parce qu’il n’en est pas totalement maître et ensuite parce que les habitudes de lecture, déjà insondables il y a un siècle, se sont dégradées considérablement. Le fait est que je suis un « survivaliste culturel » : j’écris parce que l’écriture est le soutien de toute pensée quelque peu complexe et que j’ai besoin de penser. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Ensuite, everything goes ! Pourquoi ai-je besoin de penser ? Eh bien, pour vous répondre, il faudrait que je poursuive mon travail de pensée, même si je sais bien que c’est sans fin. Il y a des gens qui me lisent et qui me parlent de ce livre, que je croyais être mien et dont je découvre dans leur regard qu’il est aussi quelque chose d’autre, dont je n’étais pas très conscient. La pensée fonctionne comme cela, surtout dans le dialogue, dans l’oralité vive d’une conversation : on se comprend enfin à proportion de ce que l’on doit s’expliquer devant autrui. En fait, on se comprend de mieux en mieux par ce truchement.
Pour ai-je écrit ce livre ? …pour des gens – alors là, c’est un pari de confiance – …pour des gens qui auront envie d’aller lire ou relire le Portrait de Dorian Gray parce qu’ils s’intéressent à Oscar Wilde, et puis aussi les artistes, les écrivains eux-mêmes, les gens de théâtre et peut-être même ceux qui ont aimé mon précédent livre sur l’auteur de Salomé.
RJ Qu’est-ce que vous voulez qu’on retire de ce livre ?
FP Mon ambition est que chacun, en venant retirer d’un tel livre ce qu’il pensait y trouver, se comprenne mieux et découvre suffisamment de nouveauté pour mieux saisir à la fois mon propos et son propre désir. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus, à commencer par le profil sulfureux d’Oscar Wilde que l’on va aduler ou exécrer d’emblée sans se donner la peine de le lire vraiment. En filigrane au Portrait de Dorian Gray, que l’on retrouvera par conséquent, dans mon essai littéraire, est cette terreur diffuse que tout d’abord l’on identifiera comme un élément fondamental du cahier de charges du genre fantastique, mais elle est l’image, peinte dessus et ton sur ton d’une tout autre angoisse, une angoisse totalitaire qu’intériorisent muettement toutes les victimes des discriminations actuelles. Oscar Wilde, de propos délibéré, n’a pas voulu mêler à sa fiction des considérations morales ou de mœurs. L’étrange mutation maléfique que subit le portrait est, sans explication aucune, ce qui semble rendre visible l’invisible corruption de l’âme de Dorian Gray. Est-ce le fruit d’un pacte faustien, qui offrirait la jeunesse éternelle pour prix d’une âme, laquelle en fait est particulièrement médiocre ? Cette laideur insoutenable est-elle la traduction de l’hubris dionysiaque et bientôt bestiale et criminelle qui est la conséquence quasi mécanique de l’absoluité du pouvoir profondément transgressif, qui est celui de séduire à coup sûr sans jamais devoir douter de sa propre aura ? Ou bien est-ce la tonalité fondamentale de l’éthos homosexuel, du moins dans l’éclairage stigmatisant du XIXème siècle ? Et si cela était, cette laideur accomplie provient-elle de la situation existentiellement transgressive de l’homosexuel, alors qu’il la vit comme une malédiction ontologique et peut-être même démoniaque, ou bien est-elle l’effet indirect – et la couleur de fond, des plus sombres – d’une société qui fixe volontiers l’immense accumulation de cette haine sociale dont elle est à tout moment capable sur l’une ou l’autre cible : l’homosexuel, mais aussi le juif pour les antisémites ou encore les personnes racisées à une époque caractérisée par un colonialisme particulièrement décomplexé ?
C’est à la fin de mon livre que je pose la question, en révoquant en doute l’exceptionnalisme gay dont Wilde est le paradigme à la fois générique et exceptionnel. En effet, que l’on interroge aujourd’hui des femmes battues, agressées ou violées, des Juifs ou des Arabes persécutés, ou encore des Blacks racisés, ou encore des gens qui ont été molestés dans leur enfance, des souffre-douleurs de toute sorte… leurs réponses vont toutes converger vers une problématique commune qu’elles dessinent chacune à leur manière : ce qu’il y a de commun dans tous ces cas, à mon sens, est une certaine condition victimaire où l’agressé intériorise à son corps défendant le stigma que lui inflige l’agresseur. D’où la honte envahissante. D’où l’angoisse paranoïaque de l’homosexuel victorien, que Wilde restitue assez finement, sans y toucher, sans dire les mots, à travers la seconde partie de son livre, quand Dorian Gray prend conscience de ce qu’il est, pour ainsi dire, cerné par une justice invisible, dont il ne sait pas si elle divine, démoniaque ou simplement humaine… Certes, le portrait est chargé et Dorian Gray est allé, sans ciller, plusieurs fois jusqu’aux crimes les plus violents et les plus bas. Voilà ce que je voudrais que l’on retire de mon livre, si toutefois on le lit jusqu’au bout et que l’on puisse appréhender à partir de mes analyses cette condition victimaire qui est assez générale dans son étiologie, toute tendance confondue, et surtout qui n’est pas exclusivement le fait des homosexuels, ceux dans l’Angleterre victorienne ou ceux du monde d’aujourd’hui. D’ailleurs, pour autant qu’ils tiennent bon et ne se suicident pas – les taux sont considérables, 5 à 7 fois la moyenne normale, en France – ceux-ci peuvent même développer des personnalités et des vies fantastiques… Mais tout le monde n’est pas Wilde ! Dans le même lot, souffrant des mêmes maux et des mêmes traumas, il y a tous ceux et toutes celles que peut cibler la haine sociale, à l’infini. Entretemps, les États-Unis basculent dans une société où la haine sociale est exaltée, dans des proportions elles-mêmes « fantastiques »… Pour moi, c’est important ! Je préférerais que le lecteur de mon livre passe à côté de tout le reste mais au moins qu’il saisisse cela.
RJ Ma dernière question : quels sont vos prochains projets ?
FP Faust. Parce que je vais donner en 2026 donner sur ce mythe de Faust quelques conférences aux Matins-Philo dont il faut faire un peu la pub, je compte sur vous. Je ne vous en dis pas plus. https://lesmatinsphi.be
Présentation du livre sur le site de l’éditeur:
« Un être vivant peut être dit beau, de même qu’une oeuvre d’art. Pour Oscar Wilde, la beauté du premier appelle à la seconde, et l’éros inhérent au désir ne prend sa véritable ampleur que dans la création, qu’elle soit picturale ou littéraire. Cette puissante dialectique se traduit par une architecture conceptuelle d’une rare sophistication philosophique, dont le Portrait de Dorian Gray manifeste les lignes de force dans le prisme chatoyant d’une fiction fantastique. C’est qu’en effet Wilde écrivain se veut davantage visionnaire qu’analyste : l’expérience de la beauté est en elle-même une vision surnaturelle et mystique dont la magie propre serait au demeurant magiquement naturelle, c’est-à-dire sexuelle. Wilde subit et revendique à la fois sa propre obsession pour la beauté qu’il voit comme le « symbole des symboles » qui « révèle tout parce qu’elle n’exprime rien ». Cette obsession de toute une vie tient autant de sa personnalité singulière que de la paranoïa farouche de l’époque victorienne à l’encontre de la chair et du plaisir, qui fait muter le désir en son autre : une rage haineuse, agressive et répressive dont la magie noire se fait encore sentir aujourd’hui. C’est ce qui transparaît, à la longue, dans ce portrait délicieusement maléfique. »