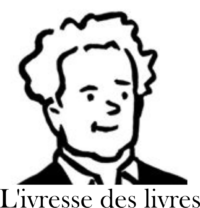Luc Dellisse, Le temps de l’écrivain, Essai, ISBN : 978-2-39070-236-8, 192 pages, Les Impressions nouvelles.
Les lecteurs de Luc Dellisse aussi bien que les visiteurs de son blog « L’inconnu » (dont quelques chapitres y furent publiés) se réjouiront de retrouver dans ce volume la manière qu’a le romancier-poète-essayiste d’entrelacer les impressions que lui inspire le quotidien à sa capacité de les transcender et de leur donner forme. Dans une langue dont il célèbre dès les premières pages la nécessité impérieuse d’en exploiter toute la richesse, Dellisse mêle au gré de la cinquantaine de chapitres du volume, l’écho de sa propre confrontation à l’écriture dont il propose une résonance bien au-delà de l’expérience personnelle. On pourrait tenter de formuler cette résonance sous forme de questions. À quoi bon écrire ? Qu’est-ce qu’un écrivain ? Quelle place a encore la littérature aujourd’hui, du point de vue de l’écrivain comme du lecteur ?
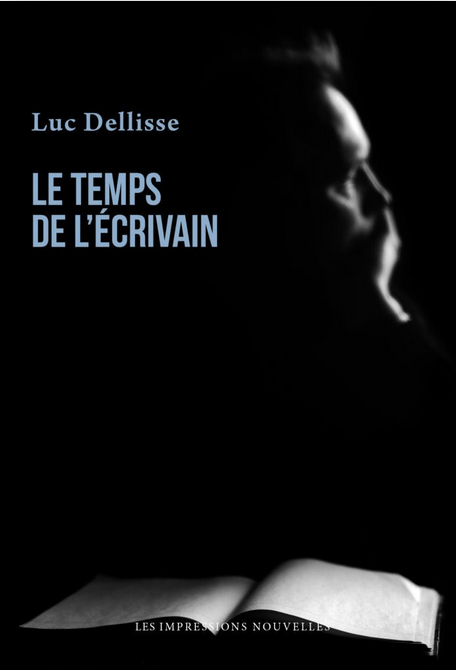
Dans ses textes courts que l’on peut découvrir aussi sur sa page Facebook, Dellisse aime à s’interroger par le truchement d’une figure imaginaire, qui lui ressemble, par la manière d’écrire le quotidien, ses petits incidents, ses éclats de lumière comme ses sombres états. À le lire dans cet exercice régulier, on imagine une silhouette semblable à celle d’un Corto Maltese, traversant les jours en quête de ce que lui et nous ignorons, mais qui nourrit la page. Sans doute est-ce là à chaque fois l’illustration de ce que Dellisse exige d’un « écrivain aux yeux ouverts, il faut beaucoup d’amour, un culte de la vérité surtout dans les petites choses, et une humilité secrète parce qu’on sait qu’on n’est que le témoin d’une histoire dont on n’est pas l’auteur. ». La littérature, et c’est essentiel dans la démonstration de Dellisse, est le dernier acte qui exige d’être réalisé dans la solitude, donc dans la plein responsabilité, assumée d’une seule personne, l’écrivain face à sa page ou à son écran, qu’il va transformer en « une vision du monde ».
Ici n’est pas le lieu d’une synthèse, par ailleurs impossible tant le livre est riche, et son double sujet (l’écriture et l’écrivain) démultiplié en autant de points de vue que de pages, voire de paragraphes. Et ce n’est pas la moindre des qualités de l’ouvrage : on pourrait, en s’équipant d’un crayon, y souligner tant de propos brefs qui semblent dès qu’ils ont été lus, devenir nôtres pour autant que l’énigme du littéraire nous attire. A la manière de Montaigne, l’auteur prend appui sur des souvenirs, sur des expériences du quotidien – dont il met en évidence la sensation laissée davantage que la description objective -, son insertion dans le quotidien d’un monde auquel il est finalement étranger, sa place dans la société. A la différence de l’auteur – moraliste et philosophe- des Essais, Dellisse explore la dimension poétique du monde devenu roman. « La tenue de l’histoire n’est rien si elle ne s’accompagne pas d’une constante puissance poétique », observe l’écrivain. De chapitre en chapitre, le lecteur accompagne la pérégrination de celui qui interroge, s’interroge, se souvient, s’inquiète, et chaque fois formule avec une précision sans faille ce qui a fait (et continue de faire ) sa destinée : « déduire des accidents et des hasards de sa vie le récit continu et secret d’une solitude heureuse. »
Peut-être ce bonheur est-il quelque peu assombri comme on le lira dans les pages plus « personnelles » de l’essai ? Dans le chapitre « notoriété », l’écrivain « <admet> sans peine que la réussite ne fait pas partie de <son> œuvre. ». Cette réussite-là, il la calcule en nombre d’années consacrées à écrire, en nombre de livres publiés et en calcul du tirage… Heureusement, il achève son raisonnement – son calcul plutôt -, en cette évocation du bonheur d’être soi qu’il formule en désignant ses livres : « Ils m’ont fait écrivain en chair et en os, ils m’ont donné un regard, un être-au-monde, un corps même qui ne se comprennent pas si on n’y ramène, de mes gestes et de mes jours d’écriture, exactement tout. »
Voici un livre qu’une seule lecture n’épuise pas. Le crayon a souligné les phrases, les paragraphes qui marquaient la première d’entre elles. On reprend le livre, devenu objet corné, plié, annoté, et on y trouve à chaque fois une nouvelle manière d’exprimer le bonheur d’ « effectuer la métamorphose du réel », fut-ce dans cette solitude indissociable de l’écriture. On s’attarde aussi alors à des chapitres lus une première fois pour l’anecdote que leur titre semble annoncer (« L’écrivain sans œuvre ») ou pour appréhender la chaîne du livre (« Des éditeurs ») ou pour découvrir la perception de l’écrivain face à l’envahissement des textes produits par l’Intelligence artificielle.
Chaque fois, Dellisse identifie un chemin inattendu pour nous dire ce que cela éveille en lui et ainsi, nourrit-il chez le lecteur, l’insatiable appétit de lire.
Jean Jauniaux, le 21 septembre 2025.
Nous avions interviewé Luc Dellisse à différentes reprises. Ces entretiens sont toujours disponibles à l’écoute en cliquant ici.
Sur le site des Impressions nouvelles:
La littérature est en état d’alerte générale. Tout le monde semble d’accord là-dessus. Les éditeurs, les libraires, les diffuseurs, les journalistes ont cessé d’être simplement inquiets : ils ont adopté le pessimisme comme feuille de route. Les médias, accompagnant à leur manière le recul de la création, sont les premiers à sonner le glas. La littérature va mal, la lecture va mal, le métier va mal. Tel est le leitmotiv récurrent. Et les écrivains, dans tout cela ? Pour un créateur véritable, lancé dans son entreprise comme dans une course de fond, ce requiem n’est pas nouveau. Tout s’est très mal passé depuis toujours : rareté, pauvreté, incompréhension. Certes, les données actuelles ne sont pas bonnes. La baisse du niveau scolaire, l’anémie de la langue, le règne des écrans, le recul de la lecture, la poussée invincible de l’intelligence artificielle, créent un contexte particulier à l’acte d’écrire, dans ce siècle a-littéraire. Mais le pari de faire une œuvre et de créer un cercle de lumière autour de soi reste ce qu’il est depuis près de mille ans : solitaire et radical. Être écrivain est une aventure sans garde-fou. L’enjeu : se servir de la langue, la plus forte, la plus souple possible, pour donner une durée au présent. En somme, c’est une chevalerie. On part à la recherche du Graal et le Graal n’est probablement qu’une légende. Mais aucune autre mission ne saurait être plus féconde. Seule la littérature a le pouvoir de changer les faux semblants en musique de vérité. Dans un monde déchiré, l’acte d’écrire dissipe les mirages. C’est une activité unique et par là même, irremplaçable. On n’en a pas encore fini avec les écrivains.