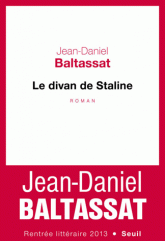L’argument de ce neuvième roman de Jean-Daniel Baltassat est né d’une visite qu’il effectua naguère dans le palais Likani à quelques kilomètres de la ville de Borjomi. Dans cette résidence d’été, datant de la Russie Tsariste, Staline aimait à se retirer. Le roman de Baltassat évoque un bref séjour que le Petit père du Monde y effectua en 1950. Le roman s’ouvre sur le vieux dictateur en train de couper des roses et de méditer sur la mort, sur l’éphémère et sur l’éternité. Rêverie de vieillard plutôt que méditation. En effet, « la mort est le souci des faibles , pour les puissants, c’est une œuvre qui se prépare de loin » Et Staline « vieux dans le sac d’os, (est) encore joueur comme à vingt ans pour ce qui est du reste et du goût de l’éternité ».
Prenant appui sur ces quelques jours, Baltassat entre et nous fait entrer dans une intimité sidérante avec Staline, que le romancier met littéralement à nu. Ici, il ne s’agit pas d’une créature imaginaire, mais d’une figure réelle et terrifiante, dont chacun d’entre nous a déjà une image, nourrie des représentations qui ont jalonné le règne du tsar rouge.
Baltassat sait que le roman est un formidable instrument d’investigation de l’Histoire (« avec une grande Hache » comme aimait à dire George Perec). En se fondant sur une documentation d’autant plus riche que des archives ont été rendues accessibles – de façon éphémère il est vrai…- lors de la perestroïka, le romancier affronte le titan avec ses armes d’écrivain. Il invente une unité de temps et de lieu qui met à vif la conscience, exacerbe la confrontation des protagonistes, les vrais et les « faux », les réels et les imaginaires. Par cercles excentriques successifs, Baltassat part de l’inconscient le plus intime de Staline (révélé lors de simulacres de psychanalayse sur le « divan « qui donne son titre au livre), aux différentes pièces du Palais Likani – organisation en réduction du pouvoir soviétique, avec l’armée, le service secret, la police politique, le petit peuple prosterné, l’ombre de Lénine…- ; il nous en éloigne à intervalles réguliers pour hanter le parc du Palais – comme une maquette de la Russie, indéchiffrable, vibrant du jeu de la lumière et des brouillards, hantée par les silhouettes menaçantes des forces de l’ordre et de la sécurité, à moins que ce ne soit une représentation du Goulag…- ; il nous en écarte encore pour élargir l’espace aux conflits qui se préparent dans le monde – nous sommes à la veille de la Guerre de Corée- et revenir ensuite au plus près de Staline, insomniaque informé à chaque instant de ce qui se déroule où que ce soit…
Le prétexte de ce séjour dans sa Géorgie natale est aussi imaginaire que plausible : rencontrer l’auteur d’une projet de « monument d’éternité » que le Politburo veut élever à la gloire du Petit Père. Un jeune artiste prodige, Danilov, a été convoyé dans le Palais et attend – enfermé avec la maquette de son projet dans une remise de calèches – le moment de rencontrer Staline. Pendant ce temps, le dictateur vaque au jeu de la terreur, vérifie qu’il l’inspire toujours, se confronte aux souvenirs d’enfance et de jeunesse qui le hantent dans des rêves à l’imagerie inspirée des westerns qu’il se fait projeter pendant ses insomnies.
Danilov, l’artiste de l’éternité , et Lidia, l’ancienne maîtresse, incarnation du passé et de la conscience, sont des inventions que le romancier introduit dans la réalité « historique ». Armé de ces protagonistes Baltassat aborde la confrontation d’un des plus sanguinaires dictateurs du siècle dernier, avec sa conscience et sa mort.
On le sait, l’argument ne fait pas un roman, il est son énergie de départ. Baltassat s’arcboute sur l’histoire qu’il nous raconte, sur les inventions qu’il mêle au réel – n’avons-nous pas vérifié si Danilov était vrai ou pas ?- pour nous laisser, sidérés, à la fin du livre, devant ce qui aurait pu être une métaphore absolue de la barbarie si cela n’avait été une réalité de l’histoire du Goulag sibérien telle qu’elle s’est déroulée en 1933 sur l’île de Nazino.
Une fois le livre refermé, ne nous quittent plus ces images tant le romancier nous les a donné à voir, à sentir, à entendre. On se demande s’il est peintre, cinéaste, musicien et romancier à la fois. On pressent alors qu’il nous a entraîné dans un cercle ultime, celui qui nous guettait entre les lignes et nous interrogeait en réalité sur l’affrontement entre la barbarie et l’humanité. Mais aussi, entre le pouvoir et l’Art. Mais encore entre la mort et l’éternité.
Un roman exige du lecteur « la suspension volontaire de l’incrédulité » (Coleridge). Baltassat, jouant de la vérité inaccessible de l’Histoire et du mensonge indispensable de la littérature, nous plonge dans une suspension salutaire de l’aveuglement.
N’est-ce pas ce dont notre époque a le plus grand besoin ?
N’est-ce pas la fonction de l’art ?
Et de la littérature – lorsqu’elle est de ce niveau-ci- ?
Edmond Morrel
(Entretien avec Jean-Daniel Baltassat réalisé chez l’auteur, dans la Creuse)
PS : Dans ses remerciements, JD Baltassat rend , entre autres, hommage à Vassili Grossman. L’occasion nous est donnée ici, comme lui, de « payer tribut à l’immense auteur de Vie et Destin prodigieux chef-d’œuvre romanesque du siècle chien-loup »
1950. Borjomi, Géorgie.
Pour quelques jours, Staline se retire au pays natal dans le palais décadent de feu le grand duc Mikhailovich. À la demande de la Vodieva, qui prétend l’avoir toujours aimé et ne lui avoir jamais menti, il y reçoit le jeune peintre prodige du réalisme socialiste, Danilov, concepteur d’un monument d’éternité à la gloire du Petit Père des Peuples.
Dans le bureau ducal, un divan identique à celui de Freud à Londres. Même kilims sur la couche et aux murs. « Que Staline dorme sur le divan du charlatan viennois, j’en connais à qui ça plairait de l’apprendre », dit Iossif Vissarionovitch.
On a beau être dans l’âge de la grande usure des émotions, on a encore le goût du jeu.
Voilà comment les choses vont se passer : pendant que Danilov subira les interrogatoires du redoutable général Vlassik, Staline s’installera sur le divan et la belle Vodieva prendra le fauteuil. Elle pratiquera la prétendue technique d’interprétation des rêves du charlatan tandis que lui se souviendra de ses histoires de nuit. L’enfance, sa mère, les femmes. Et surtout, le plus grand des pères menteurs : Lénine. Mais qui, mieux que Iossif Vissarionovitch Staline, saurait faire d’un mensonge une vérité et d’une vérité le mensonge ?
« Camarade Danilov, dit-il, la vie est devenue meilleure et plus gaie, voilà l’éternité de Staline. »
Danilov tremble devant celui qui sait tout et peut tout. Il tremblerait plus encore s’il savait ce qui l’attend.